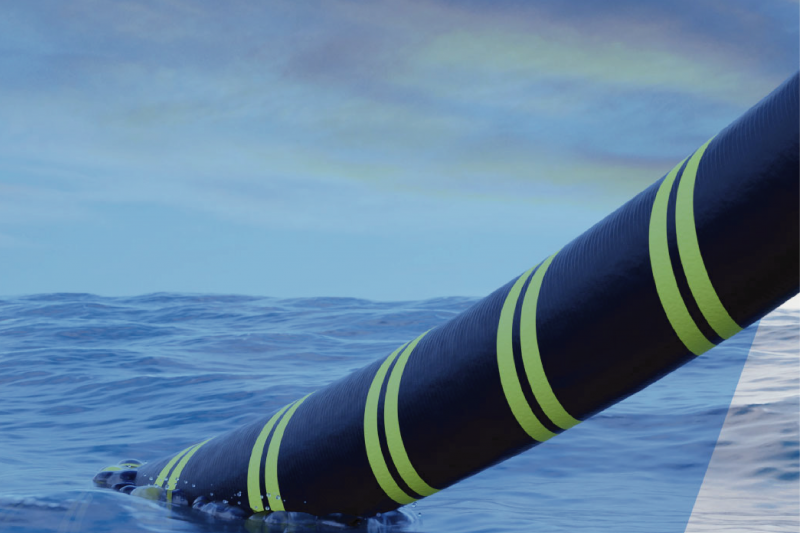Stress hydrique : la stratégie 'Génération Green' va-t-elle tomber à l’eau ?
ENTRETIEN. Face à la situation de sécheresse quasi chronique et de stress hydrique structurel, le professeur Mohamed Taher Sraïri considère que le Maroc doit revoir de fond en comble sa politique agricole pour l'ajuster aux ressources en eau du pays et à la crise climatique qui ne fait que commencer.

Stress hydrique : la stratégie 'Génération Green' va-t-elle tomber à l’eau ?
Partager :
-
Pour ajouter l'article à vos favorisS'inscrire gratuitement
identifiez-vousVous possédez déjà un compte ?
Se connecterL'article a été ajouté à vos favoris -
Pour accéder à vos favorisS'inscrire gratuitement
identifiez-vousVous possédez déjà un compte ?
Se connecter
Mehdi Michbal
Le 25 juillet 2022 à 19h10
Modifié 26 juillet 2022 à 15h50ENTRETIEN. Face à la situation de sécheresse quasi chronique et de stress hydrique structurel, le professeur Mohamed Taher Sraïri considère que le Maroc doit revoir de fond en comble sa politique agricole pour l'ajuster aux ressources en eau du pays et à la crise climatique qui ne fait que commencer.
Dans son dernier rapport sur la situation économique du pays, la Banque mondiale a fait un focus sur la problématique de l’eau au Maroc, considérant que le Royaume fait désormais face à des sécheresses structurelles, à une situation de stress hydrique et s’approche du seuil des pays qui vivent en situation de « pénurie d’eau ». L’institution mondiale établit un diagnostic que l’on connaît bien au Maroc, surtout avec la forte sécheresse de cette saison 2021-2022, les ravages produits dans l'agriculture et les risques qui pèsent sur l’eau potable.
Dans son rapport, la Banque mondiale propose une recette assez directe : augmenter les tarifs de l’eau comme seule solution pour valoriser la ressource et rationaliser son utilisation. Mais ne va pas jusqu’à remettre en cause les politiques agricoles du pays qui, selon son économiste principal pour le Maroc, ont produit des effets positifs sur l’emploi, le revenu des ménages, la croissance de la valeur ajoutée agricole et des exportations.
« C’est à la politique de l’eau de s’adapter à la politique agricole, et non le contraire », soutenait Javier Cassou Diaz à l'occasion d’une table ronde organisée mercredi dernier pour la présentation du rapport.
LIRE AUSSI : Augmenter la tarification de l’eau : la recette de la Banque mondiale pour éviter la panne sèche
Mohamed Taher Sraïri est enseignant chercheur en agronomie à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II). Nous l’interrogeons ici sur l’ensemble de ces sujets liés à la rareté de l’eau, aux choix de politiques agricoles, aux solutions qui peuvent être envisagées... S’il partage le diagnostic de la Banque mondiale, ainsi que sa recette d’augmentation des tarifs qu’il dit avoir défendue il y a des années déjà, il appelle en revanche à une refonte globale de la politique agricole du pays. Et appelle même, dans ces conditions de « détresse hydrique », à arrêter de considérer l’agriculture comme un vecteur de développement du pays.
Médias24 : Avec la situation de stress hydrique structurel que l’on vit actuellement, et des années de sécheresse qui deviennent la règle – trois sécheresses sur les quatre dernières saisons –, pensez-vous que notre politique agricole 'Génération Green 2020-2030' tient toujours la route ?
Mohamed Taher Sraïri : Ma réponse est claire depuis dix ans déjà, avant même qu’on ne soit dans cette situation de sécheresse répétitive. Je disais que le Plan Maroc Vert ne tenait pas la route par rapport à cette question de l’eau. Parce que les ambitions agricoles n’étaient pas calibrées en fonction de la disponibilité en eau et des disparités de ces disponibilités. Le problème est là.
Le Maroc est un pays très divers, on ne peut que s’en féliciter. Mais quand vous avez des endroits quasiment désertiques, comme les oasis, ou des endroits un peu plus favorables, comme les plaines atlantiques, vous ne pouvez pas avoir une politique agricole uniforme qui s’applique à tout le territoire. Malheureusement, dans le Plan Maroc Vert, le mot « eau » n’existe même pas…
- Mais le Plan Maroc Vert n’a pas omis l’approche territoriale...
- Oui, en effet. Des programmes régionaux ont été faits en concertation avec les administrations de l’agriculture ; ce qu’on appelait à l’époque les Directions provinciales de l’agriculture (DPA) et les Offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA). Cette approche territoriale était là. Mais le problème, c’est que les disparités entre territoires n’étaient pas prises en compte.
La question centrale, c’est comment calibrer les politiques agricoles en fonction des potentialités en eau renouvelable
On s’est donc retrouvés avec des politiques laitières qui nécessitent beaucoup d’eau dans des déserts et des politiques arboricoles ou de plantations très ambitieuses dans toutes les régions, sachant que ce sont des cultures d’été.
En fait, la question centrale qui est posée, c’est comment calibrer les politiques agricoles en fonction des potentialités en eau renouvelable. Et cette question n’a pas été prise en compte. Quand je dis "eau renouvelable", je pense d’abord à la pluie, avec ses disparités interannuelles, et à un degré moindre aux barrages. Aujourd’hui, il y a moins de pluie et les barrages sont vides… On en est à un niveau alarmant. Et encore une fois, là aussi, il y a des disparités. Quand un barrage destiné à l’agglomération de Casablanca est à 5% de taux de remplissage, il n'y a plus d’irrigation en réalité…
- L’irrigation a été arrêtée cette année dans certaines régions en effet, au profit de l’eau potable qui passe en priorité en cas de rareté de l’eau…
- Bien sûr. Dans beaucoup de régions, l’irrigation a été arrêtée alors que ce sont des régions dont l’agriculture dépend fortement de l’irrigation. Cela veut dire que même les logiques anciennes de séparation entre zones pluviales, ou bour comme on dit, et zones irriguées, sont en train de disparaître avec cette crise climatique qui ne fait que commencer.
- Dans son dernier rapport sur la situation économique du Maroc, la Banque mondiale a justement fait un focus sur cette problématique de l’eau, en anticipant une baisse des précipitations pouvant aller jusqu’à 30% et en proposant comme solution d’augmenter les tarifs de l’eau pour gérer cette rareté dans le futur. Qu’en pensez-vous ?
- La Banque mondiale a effectivement mis le doigt sur une réalité dont on parle depuis des années. Personnellement, j’ai signalé dans plusieurs de mes articles qu’il y a un problème sur le prix de l’eau. On a actuellement deux choix ou décisions à prendre : d’une part, il y a un choix de spéculation qu’il faut faire pour savoir quelle culture on doit faire dans ce pays ; d’autre part, le tarif de l’eau qu’on va mettre, ou ce qu’on appelle dans le jargon agronomique, la valorisation de l’eau.
Le Plan Maroc Vert est parti avec une idée qui peut tenir sur le plan théorique. D’ailleurs, ce sont des théoriciens qui ont élaboré cette stratégie. Et cette théorie est simple : puisque les arbres valorisent mieux l’eau que les céréales, on va donc mettre des arbres partout.
Il y a des zones entières où les arbres sont en train de périr. Dans les agrumes, les gens sont en train d’arracher les arbres parce qu’il n’y pas de rentabilité, ni d’eau pour entretenir le patrimoine.
- Economiquement ou dans une logique purement financière, ce choix se tient car le revenu de nombreux agriculteurs a augmenté ces dix dernières années…
- Je dirai que ça se tient sur le plan théorique, mais pas économique. Car la logique économique voudrait qu’on intègre aussi la variable eau.
Dans la pratique, cette théorie doit être testée par rapport aux capacités en eau. Les céréales, c’est de l’eau pluviale. Alors que si vous mettez des pêches, des nectarines ou des oliviers qui se sont développés à grande échelle, il faudra les irriguer du mois de mai jusqu’en octobre. Et là, avec la rareté de l’eau, on ne parle même plus des cultures, mais on est confrontés à un problème de sauvegarde du patrimoine. Il y a des zones entières où les arbres sont en train de périr. Dans les agrumes, les gens sont en train d’arracher les arbres parce qu’il n’y pas de rentabilité, ni d’eau pour entretenir le patrimoine.
Notre pays est en train de s’assécher. On a malheureusement négligé l’agriculture traditionnelle, cette agriculture pluviale qui a toujours fait ce qu’est le Maroc.
- Vous rejoignez sur ce point le Haut-commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi. Il a tiré la sonnette d’alarme sur l’abandon de cette agriculture traditionnelle qui, d’après lui, représente la perte d’un savoir-faire ancestral de gestion de la rareté…
- Exactement. Car on n’a pas encouragé les gens qui travaillent dans cette agriculture. Les jeunes veulent quitter la campagne. Je suis membre d’une association internationale, l’International Association in Working Agriculture (l’IAWA), qui s’intéresse à la question du travail dans l’agriculture, un sujet primordial. Car l’agriculture demande des bras, beaucoup de main-d’œuvre. Au Maroc, 40% de personnes actives travaillent dans le secteur agricole, soit à peu près 4 millions de personnes…
- Quand vous dites agriculture, vous y intégrez l’élevage ?
- Oui, bien sûr. C’est un tout. L’élevage, justement, consomme énormément d’eau, et c’est de l’eau pluviale. Quand vous voyez un petit fellah qui fait pâturer cinq vaches au bord de la route, on n’a pas idée qu’il valorise à la fois l’eau pluviale, son travail, et fait pousser de l’herbe. Les vaches, à la différence des cultures, il faut s’en occuper tous les jours. D’ailleurs, dans le langage des ingénieurs agronomes, on dit que l’élevage est un travail d’astreinte quotidienne. Mais aujourd’hui, quand vous mettez en équation l’eau et le travail, le compte n’y est pas.
On a automatisé l’agriculture, surtout dans les grandes exploitations agricoles, en croyant que ça allait générer des économies d’eau. Or, on se retrouve aujourd’hui dans une situation où il faut entretenir ces arbres car ils ont besoin d’eau.
Et avec le conflit actuel en Ukraine, les prix de tous les intrants agricoles se sont multipliés par trois, quatre, voire cinq. C’est beaucoup plus que les hydrocarbures. Le prix de l’engrais azoté par exemple, primordial pour l’agriculture, a été multiplié par cinq.
- Le Maroc importe de l’engrais azoté...
- Oui, bien sûr. Et on l’achète essentiellement dans des pays impliqués par le conflit actuel. Donc quand vous ne faites que des arbres, que vous dépendez de ces intrants importés et que vous ne faites pas d’élevage qui peut vous fournir du fumier, vous arrivez à une situation catastrophique.
Il faut reconsidérer de fond en comble toute notre politique agricole.
Avec le Plan Maroc Vert, on a monté grâce à des subventions étatiques de grandes fermes de dizaines d’hectares avec zéro animal. Ces fermes sont aujourd’hui bloquées à cause du surcoût des intrants et de l’augmentation des prix des produits énergétiques. Sans parler de la baisse de la demande sur le marché mondial. Ceci pousse les gens a arracher des rares arbres, un peu partout… La situation est très complexe.
- Que faut-il faire alors, revoir toute la politique agricole du pays ?
- Il faut reconsidérer de fond en comble toute notre politique agricole.
- Mais jusque-là, vous parliez plutôt du Plan Maroc Vert, sachant qu’il y a une nouvelle stratégie 2020-2030 qui est venue corriger certains points négatifs de Maroc Vert. La stratégie Generation Green est-elle à revoir également ?
- L’idée première de Génération Green est de continuer sur cette voie du Plan Maroc Vert, celle de la plantation de plus d’arbres, avec plus de goutte à goutte, pour augmenter la production et les volumes à l’export. Ce qui, à mon avis, est une erreur absolue. J’ai l’impression que nos politiques continuent à avoir le même discours et pensent que le goutte à goutte est la solution pour gérer la rareté de l’eau. Le goutte à goutte n’est qu’un tuyau ; encore faut-il avoir de l’eau pour l’alimenter. Or, cette eau n’existe plus aujourd’hui.
Un des résultats de tout cela, c’est l’épuisement des nappes. Je vous donne un exemple très parlant, dans la région de Ain Allah, à côté de Fès. On est dans l’endroit le plus favorable du Maroc, au Moyen Atlas, ce que les colons français appelaient le "château d’eau du Maroc". A Ain Allah, il n’y a quasiment plus d’eau aujourd’hui.
Quand on parle d’économie d’eau, c’est d’abord l’agriculture qui est concernée. Il faut arrêter de nous dire que le gaspillage de l’eau provient des villes et des usages domestiques. 90% de nos ressources en eau vont dans l’agriculture.
L’eau souterraine, les nappes, c’est l’agriculture. Aujourd’hui, on n’a plus de nappes dans plusieurs régions du pays.
Maintenant, la stratégie Génération Green a aussi du bon. On ne critique pas du tout. Elle a essayé de remettre l’homme au centre des politiques de développement, avec l’ambition de faire émerger une classe moyenne rurale en essayant de corriger les imperfections du Plan Maroc Vert, qui était centré autour de la productivité au profit d’une classe de privilégiés.
Mais on est aujourd’hui face à nos limites. Et la plus grande, c’est l’eau.
- Le tout dans un contexte où la sécurité alimentaire devient un enjeu crucial…
- Moi, je parlerais même d’un défi de souveraineté alimentaire. Il faut qu’on pose les mots à leur place. On est en droit d’exiger que ce pays recommence à parler de souveraineté alimentaire, produise l’essentiel de ses grains ; l’huile qu’on ne produit quasiment pas puisque 98% de l’huile quotidienne consommée au Maroc est produite à partir de grains importés (tournesol, maïs, colza...).
Quand on évoque les produits du terroir, c’est marginal en termes de ce que consomment les Marocains. Si vous faites un tour dans les villes marocaines, là où il y a l’essentiel de la consommation, on retrouve quoi ? Les mahlabates (les laiteries, ndlr), c’est tout ce qui est produits laitiers, pain, grains de céréales… Et tout ce qui est frit avec de l’huile. Tous ces produits qui sont consommés au quotidien par la grande majorité des Marocains dépendent des importations.
Moi je ne parle pas de stress hydrique, mais de détresse hydrique, surtout dans les points les plus arides du pays
Même quand on parle d’autosuffisance dans la volaille, ce n’est pas très exact. Car les intrants pour l’élevage, le soja et le maïs, sont importés.
Il y a une discussion très sérieuse à avoir sur ces sujets-là. Moi je ne parle pas de stress hydrique, mais de détresse hydrique, surtout dans les points les plus arides du pays. Et le problème se pose également en termes d’équité sociale. Il y a des endroits où il pleut 100 mm par an et ça ne profite qu’à deux ou trois privilégiés qui pompent l’essentiel de la ressource. Et les autres, les petits, se voient obligés de quitter leurs terres. Quand on en arrive à la situation où on n’a même plus d’eau à boire, l’agriculture n’est même plus dans la balance.
- On peut toutefois vous opposer que cette situation alarmante est conjoncturelle, car si la pluie est au rendez-vous cette saison, une grande partie du problème sera résolue, les barrages seront remplis. D’autant que sur le moyen terme, de gros investissements sont programmés dans le dessalement, l’interconnexion, la réalimentation des nappes afin, justement, d’accompagner cette politique agricole qu’on ne peut pas abandonner du jour au lendemain car elle est l’un des leviers de développement du pays. Elle crée des emplois, de la valeur ajoutée, du chiffre d’affaires à l’export…
- C’est une vision ultra-libérale de la chose. L’agriculture n’est pas une activité économique comme les autres. Les solutions que vous évoquez ne sont pas forcément la solution car elles coûtent extrêmement cher.
Le sociologue Paul Pascon parlait dans un de ses célèbres articles de « l’eau du ciel et l’eau de l’Etat ». Sauf que lui s’est arrêté dans les années 1980, et on ne parlait pas à cette époque de l’eau non conventionnelle. A l’époque, Paul Pascon considérait déjà que quand on passait à l’eau des barrages, qu’il appelait l’eau de l’Etat, il fallait la payer.
On a parlé de la tarification de l’eau. Si vous augmentez les prix de l’eau dans les zones desservis par les ORMVA, vous aurez un grand mécontentement.
La recharge des nappes est, elle, une option très coûteuse. Et très aléatoire.
Quant à l’eau des barrages, déjà, il faut dire que beaucoup d’agriculteurs ne paient pas cette eau. Un des gros problèmes dans les zones ORMVA, c’est le recouvrement. Et on ne parle ici que d’un prix de 50 à 60 centimes le m3.
Aujourd’hui, avec la raréfaction de cette eau, les gens sont passés à l’eau souterraine. Des milliers de puits ont été creusés. Nizar Baraka a récemment annoncé que 95% des puits au Maroc sont illégaux et non déclarés.
L’eau souterraine, il faut la payer aussi. Car il y a un investissement qui est fait en plus de l’énergie qui sert à pomper l’eau. Le tout avec une grande inconnue, puisqu’on ne sait pas à quel moment cette eau va s’épuiser. Mais de manière globale, l’eau souterraine coûte deux dirhams le m3
On passe donc de l’eau pluviale qui ne coûte rien, à l’eau des barrages qui coûte entre 0,50 et 0,60 centimes, à l’eau souterraine qui est à deux dirhams le m3. Tout cela n’est pas valorisé aujourd’hui. Si on valorise cette eau, les céréales que vous allez irriguer à deux dirhams le m3 ne seront pas rentables. Même si les gens ont commencé à se convertir aux céréales dans cette conjoncture où les prix à l’international sont repartis à la hausse.
Si on arrive à l’eau de mer, on monte directement à un prix de 6 à 7 dirhams le m3. Il n’est pas possible de valoriser une eau à ce prix avec une agriculture conventionnelle, qui produit des carottes, des aubergines… Cette eau doit être réservée à des choses plus pointues pour l’exportation.
- Sinon, ça va être impossible pour le consommateur marocain d’accepter des hausses de prix sur des produits qu’il a l’habitude d’acheter à des prix très bas…
- Ce sera impossible, en effet. Et je ne parle même pas des externalités négatives du dessalement de l’eau de mer, comme la saumure, ou les pannes répétitives – parce qu’il y a tout le temps des pannes. A mon avis, l’eau dessalée doit être réservée aux villes, pour l’eau domestique.
Ces mythes doivent disparaître. La solution est de recalibrer notre politique agricole par rapport à l’eau pluviale, de se concentrer sur les zones où il pleut encore un peu. Et d’encourager les activités qui valorisent cette eau pluviale, comme les céréales qu’on a totalement abandonnées, et la complémentarité culture-élevage, notamment la mise en valeur des coproduits des cultures, comme les pailles.
L’élevage, c’est la production de fumier, ça permet d’entretenir la fertilité des sols. On a besoin des grands principes de l’économie circulaire pour revenir à une agriculture paysanne, qui consomme très peu d’intrants étrangers. On parle d’ailleurs aujourd’hui de plus en plus dans le monde de « Low external input agriculture », qui compte surtout sur le local, avec peu d’importations d’engrais et de pesticides. On est très loin des logiques de la politique actuelle.
- Une des solutions donc, ou la solution comme le dit la Banque mondiale, c’est l’augmentation des tarifs de l’eau. Mais vous dites en même temps que si on augmente les tarifs, ça va être la révolution. Comment gérer ce dilemme ?
- Cette équation doit être résolue dans le dialogue. Il faut que le consommateur soit au courant de tout cela. Comme le consommateur accepte d’acheter le litre de gasoil à 15 dirhams, il faut lui expliquer que le lait, par exemple, consomme de l’eau, et que l’eau a un prix. Aujourd’hui, on hésite à augmenter le prix du lait, et je peux vous assurer que beaucoup d’exploitations laitières se dirigent vers des situations de cessation d’activité.
Tout cela doit se gérer avec des négociations, des arbitrages des pouvoirs publics. Car si vous touchez aujourd’hui au prix de l’eau dans les zones ORMVA, il faut immédiatement ajuster à la hausse les prix des produits finaux.
- Peut-on imaginer des stratégies de ciblage, en augmentant les tarifs pour les grands exploitants et en maintenant des tarifs bas pour le petit fellah ?
- Il ne faut pas oublier une donnée importante : ce débat ne concerne que 15% de la surface agricole du Maroc qui est irriguée par les barrages. C’est à peu près 700.000 hectares sur 8 millions d’hectares. On ne parle que d’une partie très restreinte.
Moi, ce que je défends, c’est de revenir en priorité à l’agriculture pluviale, dans ce qu’on appelait le Maroc utile du temps de la colonisation. Là où il y a moins de 200 mm par an, il faut arrêter de se mentir ; on ne peut pas faire de l’agriculture, sauf une petite agriculture pour entretenir le territoire. Il faut que les choses soient claires.
Il faut arrêter de dire que l’agriculture est une des locomotives de développement du pays, surtout avec le défi climatique auquel on fait face.
- Vous appelez donc à un changement de dogme dans notre manière de voir le développement économique du pays ?
- Tout à fait. Il est impossible de continuer à vendre l’agriculture comme une locomotive de développement alors que 80% du territoire national reçoit moins de 400 mm de pluie par an, avec l’aléa qu’on vit tous les ans et le stress thermique que l’on vit aujourd’hui. Il ne faut pas se leurrer. Quand on connaît la limite du vivant, c’est impossible d’assurer dans ces conditions un développement économique via l’agriculture.
Vous avez un projet immobilier en vue ? Yakeey & Médias24 vous aident à le concrétiser!